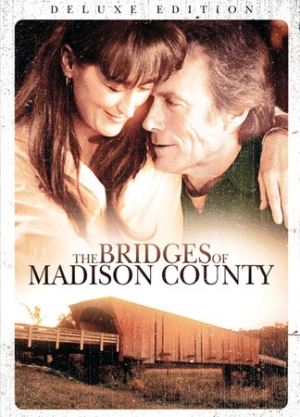A la poursuite d’Octobre Rouge, confrontation de l’œuvre à la fiction
Le film A la poursuite d’Octobre Rouge s’inspire de l’œuvre littéraire du même nom de Tom Clancy. Le commandant Ramius (Sean Connery), le meilleur sous-marinier de l’URSS, échappe au contrôle de Moscou au cours d’une mission. Il est aux commandes d’Octobre Rouge, un sous marin de type révolutionnaire, qui dispose d’un nouveau système de propulsion furtive, grâce à des chenilles dissimulées dans ses flancs. De cette manière, les ordinateurs américains embarqués dans les sous-marins américains détectent un bruit parasite naturel océanique. Ramius comprend qu’il peut profiter de ce système pour passer à l’Ouest. Il prévient ses supérieurs à Moscou par une lettre, afin de s’interdire la moindre hésitation. Ainsi, l’URSS prévenue, va tout faire pour empêcher Ramius de livrer ce sous-marin aux États-Unis. Moscou prévient Washington qu’un commandant fou s’apprête à les attaquer. Ramius a l’expérience et la dextérité pour défier toute la marine soviétique. Sa grande crainte est de savoir si les américains ont compris sa véritable intention… La traque pour retrouver Octobre Rouge est lancée.
Porté à l’écran par John Mc Tiernan (Predator et les deux premiers volets de la série Die Hard), le film connait un vif succès aux États-Unis et dans le monde entier. Le duo d’acteurs principaux fonctionne à merveille avec Sean Connery (Haute Voltige, James Bond) en Marko Ramius et Alec Baldwin (rôles secondaires dans Pearl Harbor ou Aviator) en Jack Ryan. Le film reprend l’intrigue principale du roman de Tom Clancy. On jongle entre les trois sous-marins principaux de l’intrigue, Octobre Rouge, l’USS Dallas américain, et le sous-marin russe du commandant Borodine. Les décors sont inventifs, qu’il s’agisse de la coloration particulière et subtile de chaque intérieur de sous-marin à l’ingéniosité des scènes sous-marines d’Octobre Rouge (le modèle réduit du sous-marin était accroché par une douzaine de câbles dans un décor, de façon à représenter ses mouvements. L’effet de profondeur a été obtenu par des systèmes fumigènes et une légère retouche numérique). Il aura permis à Alec Baldwin de devenir une étoile montante de Hollywood.
Pour autant, quelques points noirs ont été relevé dans ce film : en premier lieu, même si l’intrigue est prenante et quelques (rares) scènes de tension nous donnent vraiment peur pour les protagonistes, on aurait aimé, après lecture du livre, retrouver quelques traces des intrigues secondaires du roman, comme peut être, les interventions des aviations américaine et russe qui auraient été l’occasion de créer quelques scènes d’actions bienvenues. Le film tel qu’il a été écrit par les scénaristes joue sur une intrigue de thriller, la tension est permanente. Cela nous convient aussi, finalement, car la vie de sous-marinier est déjà stressante en soi, mais encore plus quand on joue seul contre tous, c'est-à-dire contre toute la flotte ennemie, mais aussi la sienne, et à cela on peut y ajouter les aviations respectives ! En fait, Octobre Rouge, on l’aura compris, est dans le roman comme dans le film, un dangereux jeu de cache-cache dans une pièce noire où les joueurs ont un bandeau sur les yeux. Ils sont sensibles au moindre bruit, et se recherchent à tâtons.
Finalement, le film c’est ça : une intrigue passionnante, des rebondissements permanents et une tension permanente. Le problème qu’on peut lui reprocher, c’est que l’intrigue s’égare par moments dans des éléments qui n’apportent rien d’important à l’histoire, et qui durent en longueur. Je pense notamment à la scène où Jack est accueilli sur le porte avion et qu’on assiste au crash de l’un des avions militaires sur le pont même du porte-avions. La scène n’émeut tout simplement pas, malgré les messages désespérés que l’on entend entre les radios de l’avion et de la tour de contrôle. Il aurait mieux valu mettre une scène supplémentaire pour montrer les avions en opération et montrer le difficile retour qui s’achève par un drame. Primo, selon moi, on aurait eu une scène d’action supplémentaire qui aurait été très appréciée, et secundo, on aurait eu davantage de peine de voir le pilote écraser son avion sur le pont, car il avait été gravement touché.
Il y a aussi d’intéressantes scènes dans ce film : par exemple, la terrible scène de la première rencontre entre Octobre Rouge et le Dallas. Pour mémoire, Octobre Rouge vient de sortir de la passe des Jumeaux de Thor et entame le « Tour d’Ivan » (nom russe en référence à Ivan le Terrible), c'est-à-dire une manœuvre de tour complet sur place pour vérifier au sonar qu’aucun sous-marin ne l’a suivi. Or, précisément dans la zone morte du sonar - l’hélice - juste derrière se trouve le Dallas, qui a enfin trouvé la trace du sous-marin de Ramius. Toute la tension consiste à suivre le tour sur place d’Octobre Rouge, tandis que les marins du Dallas tentent d’immobiliser silencieusement leur sous-marin et retiennent littéralement leur souffle, pour ne faire aucun bruit qui puisse éveiller les soupçons du sous-marin russe, quant à leur présence. J’aime beaucoup aussi la tension qui se dégage implicitement de la scène finale, mais je n’en dirai pas davantage pour ne pas dévoiler la fin de l’intrigue.
A la poursuite d’Octobre Rouge disposait d’un budget assez restreint dont il reste néanmoins un excellent film d’aventures. La musique discrète renforce des scènes dramatiques efficaces. On est fasciné par le charisme de Sean Connery, décidément très à l’aise dans son uniforme de vieux loup de mer, tandis qu’on encourage Alec Baldwin qui cherche désespérément à prouver que le commandant Ramius cherche à passer à l’Ouest. Il reste un très bon film, intemporel.
A la Poursuite d’Octobre Rouge (The Hunt for Red October), de John Mc Tiernan, 1990